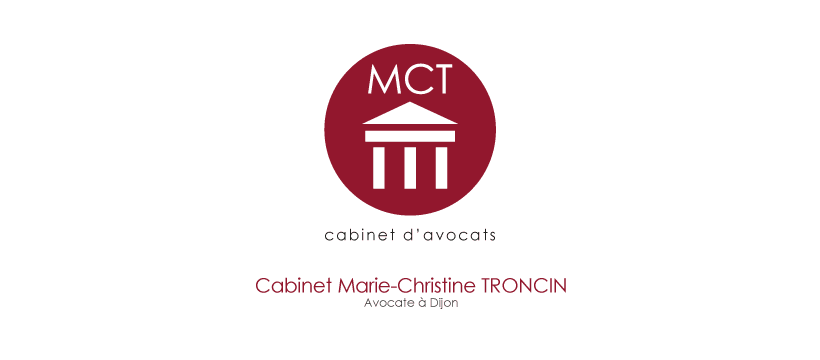
LA PRESCRIPTION DE L’ACTION EN REQUALIFICATION D’UN CDD EN CDI
Nombreux sont les salariés qui sont embauchés dans le cadre d’un contrat à durée déterminée (CDD).
Le Code du Travail (article L. 1242-1 du Code du Travail) dispose qu’« un CDD, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise. »
Malheureusement, il arrive que certains employeurs usent et abusent du CDD.
Certains salariés sont donc embauchés sous plusieurs CDD durant de nombreuses années.
C’est précisément ce qui est arrivé à un salarié qui a été embauché sous plusieurs CDD pour une période allant de novembre 2004 à octobre 2013 !
Fort heureusement, ce salarié a décidé de saisir le Conseil de Prud’hommes en 2014.
Le salarié sollicitait de la juridiction prud’homale la requalification de sa relation de travail en CDI à temps plein ainsi que d’autres demandes subséquentes (rappel de salaire, dommages et intérêts pour rupture de son contrat).
Une bataille judiciaire va s’engager.
En effet, la succession des CDD était échelonnée sur 9 années (de 2004 à 2013).
Ainsi, en juillet 2014, le salarié encourait-il la prescription de sa demande de requalification ?
La bataille judiciaire s’est terminée par un Arrêt de la Cour de Cassation, Chambre Sociale, du 29 janvier 2020 (n° 18-15359).
Cet Arrêt répond à deux questions importantes en la matière :
D’une part, le délai de prescription est de 2 ans ;
La Cour de Cassation se réfère à l’article L. 1471-1 du Code du Travail qui énonce :
« Toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit. (…) »
De seconde part, la Cour de Cassation précise le point de départ de la prescription.
En l’espèce, le point de départ part-il à compter du premier contrat conclu en 2004 ou bien du dernier contrat conclu en 2013 ?
La Cour de Cassation retient comme point de départ le terme du contrat.
En l’espèce, s’agissant d’une succession de CDD, il faut se référer au terme du dernier contrat.
EN CONCLUSION :
Si vous avez été embauché dans le cadre d’un CDD ou que vous avez fait l’objet d’une succession de CDD, vous disposez d’un délai de deux ans à compter du terme du contrat (un seul CDD) ou du dernier contrat (succession de CDD) pour solliciter la requalification de votre CDD en CDI en n’oubliant pas, bien entendu, de solliciter les demandes subséquentes de l’action en requalification (demandes relatives au rappel de salaire mais également à la rupture du contrat).

Commentaires récents